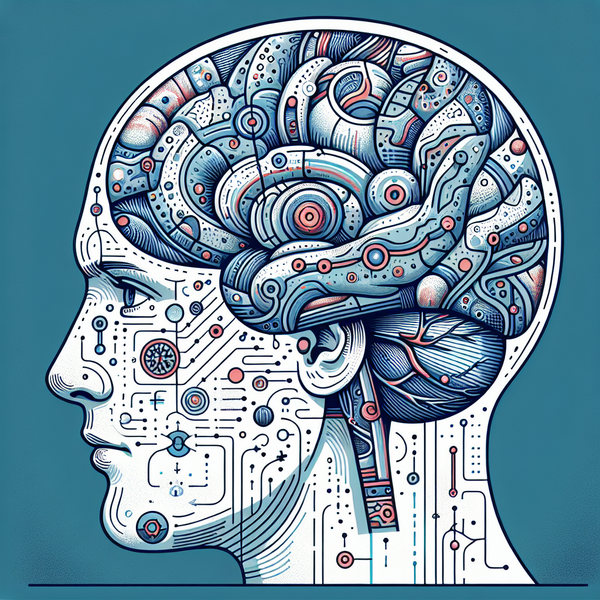 NeuroPsy ADO-ENFANT Liège POTTIER Solenn
NeuroPsy ADO-ENFANT Liège POTTIER SolennNeuroPsychologue Spécialisée Enfants - Adolescents Ados – Mme Solenn POTTIER
📍 Adresse : Rue Sous les Roches 86, 4130 Esneux
On ne les voit pas, ces blessures-là. Quand un enfant ou un adolescent subit un traumatisme crânien, les plaies physiques cicatrisent. Parfois, il ne reste aucune trace à l’extérieur. Pourtant, dans la tête, c’est un vrai raz-de-marée. Beaucoup de familles rapportent après le choc : “Mon enfant n’est plus comme avant. Il est fatigué. Il ne suit plus à l’école, il oublie tout.” C’est la fatigue cognitive, un phénomène subtil, mais redoutablement perturbant.
Vous avez eu l’impression que votre ado, d’ordinaire vif et blagueur, s’éteint plus vite qu’une pile usée ? Qu’il s’effondre après quelques devoirs alors qu’avant il tenait tout l’après-midi ?
Ce n’est pas une lubie. Cette difficulté à se mobiliser mentalement, à rester engagé dans une tâche, à mémoriser ou à se concentrer, on la retrouve chez une grande partie des enfants victimes d’un choc à la tête, même modéré.
La Belgique recense chaque année plus de 2 000 cas de traumatismes crâniens chez les jeunes, notamment à cause des accidents de sport ou de la route. Beaucoup minimisent le problème : « Il n’a rien, il se relève. » Sauf que le cerveau, lui, a pris un coup. Il est parfois comme un ordinateur ayant subi un bug : il redémarre, mais il rame, il plante, il chauffe…
Les troubles de la concentration, la mémoire en gruyère, la sensation de fatigue qui envahit l’enfant, tout cela ne relève pas d’une simple paresse ou d’un manque de motivation. Cette fatigue mentale fait partie des symptômes « invisibles » mais bien réels du traumatisme crânien léger à modéré.
Concrètement, que vivent ces jeunes ? Une fatigue qui ne passe pas, même après une nuit entière. Des maux de tête chroniques. Une irritabilité accrue. Parfois, même les émotions dérapent : le moindre petit stress devient montagne, la moindre consigne scolaire ressemble à un Everest.
Le piège, c’est que cette fatigue cognitive est largement sous-estimée. On attend que ça passe. On remet tout sur le compte de l’adolescence, de la crise, de la paresse. Pourtant, il y a là une vraie blessure, et surtout, des moyens d’en sortir.
Vous vous demandez : pourquoi mon enfant décroche, alors qu’il était bon élève ? Peut-il retrouver ses capacités d’avant ? Sommes-nous seuls à vivre ça ? Non, vous n’êtes pas seuls — et il existe de vrais accompagnements pour sortir de cette impasse.
La fatigue cognitive ne se voit pas comme une jambe cassée mais, croyez-le, elle est tout aussi handicapante. Face à un jeune qui ne reprend pas le rythme ou dont les notes dégringolent, la première réaction, c’est parfois “Il traîne, il rêve”. Mais si vous observez bien, il y a des signaux qui ne trompent pas.
Premier indice : une fatigue anormale. Un ado actif qui, soudain, s’endort dès 20h, ou qui baille sans arrêt malgré dix heures dans son lit. On ne parle pas ici de flemme banale. C’est presque comme si le cerveau, sollicité, se mettait en grève dès qu'il faut penser, apprendre, retenir.
Ensuite, la concentration vacille. Alors qu’avant le traumatisme, il pouvait rester assis pour lire un chapitre entier ou réviser une dictée, désormais il décroche au bout de quelques minutes. Les parents racontent :"On dirait qu’il oublie au fur et à mesure. Il commence une chose, puis il s’agite, il abandonne… Est-ce du TDAH, de la paresse ou un vrai problème attentionnel ?", se demandent-ils, inquiets.
D’autres symptômes sont plus insidieux : sautes d’humeur, parfois proches d’un début de dépression. L’enfant qui rentrait de l’école enthousiaste devient renfermé, se plaint, perd confiance en lui : “J’arrive plus à suivre, je suis nul.” Attention à cet effet boule de neige : le cerveau en veille, les résultats chutent, la motivation aussi… Et c’est un cercle vicieux.
Beaucoup de jeunes rencontrés à l’âge du collège, notamment aux alentours de Liège, rapportent aussi des difficultés à planifier, à organiser leurs devoirs. Ils oublient consignes et étapes, rendent des exercices incomplets, ou ne savent plus par où commencer.
Petit point à ne pas oublier : la fatigue cognitive s’accompagne aussi de plaintes physiques. Céphalées, vision trouble, vertiges, parfois même des nausées si l’effort mental est trop intense. Eh oui, penser « fait mal », quand le cerveau est cabossé. Et devant ces tableaux complexes, les médecins scolaires se retrouvent parfois démunis…
C’est ici qu’intervient le rôle clef du psychologue spécialisé en pédiatrie/neuropsychologie : savoir repérer ces signaux d’alarme et démêler ce qui relève de l’organique, du psychique et du scolaire.
Au sein de la pratique, il est fréquent de réaliser une évaluation neuropsychologique complète. Test d’attention, de mémoire, mais aussi analyse de la gestion du stress et des émotions. L’objectif ? Cerner l’origine précise des troubles, afin d’orienter la prise en charge. Parfois, le trouble cognitif cache une anxiété post-traumatique, ou un début de syndrome dépressif…
Par ailleurs, dans certains cas, on constate même une aggravation des symptômes lors du retour à l’école, ce qui complique la tâche de l’enseignant, et parfois des parents dépassés.
Alors, devant ces signes, doit-on s’alarmer ? Oui, surtout si la fatigue, les oublis ou la difficulté à se concentrer persistent plus de deux à trois semaines après l’accident. Ce n’est jamais anodin. À ce stade, le bon réflexe est de solliciter rapidement un psychologue pour enfants et adolescents ayant l’expérience des suites de traumatisme crânien. Un simple entretien peut désamorcer bien des situations… et soulager la famille.
La question revient souvent en consultation : “L’écolier d’à côté s’en est remis en quelques jours. Pourquoi pas le mien ?” Ah, si seulement le cerveau fonctionnait comme une voiture avec une date précise de révision…
En réalité, la récupération après un traumatisme crânien dépend de nombreux facteurs. D’abord, l’âge de l’enfant (ironique : un cerveau jeune, c’est plus plastique, mais aussi plus vulnérable). Mais aussi l’intensité du choc, le nombre d’accidents précédents (notamment les commotions à répétition chez les jeunes sportifs), les antécédents d’apprentissages ou d’attention (un petit déjà fragile avant peut mettre plus de temps à se remettre…)
Les facteurs psychologiques jouent aussi un rôle immense : un ado anxieux ou ultra-perfectionniste aura tendance à s’épuiser encore plus pour compenser. Un environnement scolaire exigeant, peu à l’écoute, aggrave la sensation de décalage. Et bien sûr, chaque histoire familiale est différente.
L’un des pièges, c’est la reprise « trop tôt », sans temps d’adaptation. Certains enfants, par peur de décevoir leurs parents ou parce que le collège pousse à reprendre vite, mettent leur fatigue sous le tapis. Résultat ? Crise de larmes ou effondrement en pleine classe…
À Liège, plusieurs dispositifs existent pourtant pour aménager la reprise scolaire après un traumatisme crânien, mais encore faut-il que l’école, la famille et le soignant communiquent clairement.
NeuroPsychologue Spécialisée Enfants - Adolescents Ados – Mme Solenn POTTIER
📍 Adresse : Rue Sous les Roches 86, 4130 Esneux
Vous l’avez compris : “Attendre que ça passe” n’est pas la bonne solution. Il existe, heureusement, des prises en charge vraiment personnalisées. Quand un psychologue spécialisé intervient, il ne se contente pas de “parler”. Il va utiliser des outils concrets, validés scientifiquement, pour aider l’enfant à retrouver ses ressources.
La première étape, souvent, c’est la remédiation cognitive. Concrètement ? On entraîne la mémoire de travail, on rééduque l’attention soutenue, on apprend des techniques de “récupération active” (comme pour un muscle en convalescence !). On travaille par petites doses, pour ne pas épuiser la batterie fragile du cerveau.
Exemple : Jan, onze ans, victime d’un choc lors d’un match de foot. Trois semaines plus tard, il n’arrive plus à suivre en maths, ni à retenir sa poésie. En consultation, on identifie ses faiblesses précises (attention focalisée et encodage mémoire). Pendant plusieurs séances, on structure les supports de révision, on apprend à faire des pauses régulières, à utiliser des repères visuels. Résultat au bout de deux mois ? Reprise de confiance, retour progressif des apprentissages, meilleure résistance à la fatigue.
Un autre volet essentiel, c’est l’accompagnement émotionnel. La fatigue cognitive ne vient jamais seule. Souvent, elle s’accompagne d’une peur de l’échec, voire d’un repli social. Par des techniques de “pleine conscience”, de relaxation, ou même par l’expression artistique, le psychologue aide l’enfant à déposer ses inquiétudes et retrouver du plaisir à apprendre.
Il ne faut pas négliger non plus la collaboration active avec l’école. Cela passe par la mise en place d’aménagements temporaires (allègement de l’horaire, tiers temps, limitation des devoirs), mais aussi par la formation des enseignants à la reconnaissance de ces troubles « invisibles ».
Dans certains cas, une approche multidisciplinaire est nécessaire : kinésithérapeute pour la rééducation sensorielle, orthophoniste si le langage a été atteint, et même logopède si besoin.
Parfois, une ou deux séances suffisent pour rassurer l’enfant et ses parents, et élaborer une stratégie simple. Dans les cas plus lourds, un suivi pluridisciplinaire sur plusieurs mois est indispensable.
L’erreur numéro un ? Isoler l’enfant dans sa difficulté. Au contraire, il faut l’aider à verbaliser ce qu’il ressent, à s'appuyer sur ses points forts, et à solliciter ses ressources sociales/familiales.
Vous souhaitez aller plus loin sur ce thème ? Cet excellent article sur le test de QI chez les enfants et adolescents pourrait vous donner d’autres repères sur la mémoire, l’attention et leurs particularités après un trauma.
Enfin, petit conseil pour les familles : ne pas hésiter à garder un “journal des progrès”, même minimes. Cela permet de mesurer le chemin parcouru et de valoriser les petites victoires. Un jour, votre enfant tiendra vingt minutes sans décrocher, le mois suivant trente… Chaque pas compte !
C’est la question que se posent presque toutes les familles : “Faut-il attendre plusieurs mois avant d’agir ? À partir de quand consulter ?”
Les recommandations actuelles sont claires : si, trois semaines après l’accident, la fatigue cognitive, les oublis ou les difficultés d’attention persistent, il est temps de consulter. Plus tôt on prend en charge, plus on limite le risque de chronicisation. N’attendez pas que tout s’enkyste !
À qui s’adresser ? Un neuropsychologue pédiatrique, comme Solenn POTTIER, est formé à l’évaluation fine des troubles post-traumatiques. L’accueil y est bienveillant, et un premier entretien peut déjà faire grandir l’espoir. L’objectif est de dédramatiser ("Ce n’est pas une fatalité"), d’objectiver (“Voilà ce qui fonctionne encore bien, ce qui coince”) et de planifier (“On va y aller étape par étape”).
Le rôle du psychologue pour enfants ne se limite pas au bureau du praticien. Un vrai travail de réseau existe à Esneux à Liège et dans les environs, pour guider les parents dans le maquis administratif, scolaire et médical.
Il est aussi primordial d’impliquer l’école et toute la famille. Parfois, une rencontre tripartite (famille-enfant-enseignant) clarifie la situation : non, il n’était pas “faignant”, oui, il est encore en fragilité… Et chacun repart avec un rôle précis.
Le saviez-vous ? Il existe des groupes de parole pour jeunes victimes de TCC (traumatisme crânien cérébral) en Belgique, avec intervention de psychologues spécialisés. L’occasion de partager ses galères, de comprendre que « non, tu n’es pas tout seul ».
L’expérience montre que l’immense majorité des enfants accompagnés dans les premiers mois récupèrent 80 à 100% de leurs capacités. Plus on attend, plus le retour à la normale est difficile. Le cerveau, comme une fracture, a besoin qu’on le bichonne dès le départ.
Les témoins de cette démarche active sont nombreux : “On a enfin compris ce qui se passait, arrêté de se disputer le soir autour des devoirs. Il ne guérit pas plus vite, mais il souffre moins. Et nous aussi.” Parfois, ces mots valent tous les traitements du monde.
Pour les parents, il est naturel de se sentir désemparés devant ce tableau complexe. Les psychologues spécialisés proposent fréquemment des séances d’accompagnement parental : comment doser les encouragements, repérer une éventuelle souffrance psychique associée, éviter de surprotéger, etc.
Sur ce sujet, vous pouvez également lire cette ressource sur la gestion de la culpabilité parentale, un sentiment assez classique après une telle blessure : apprendre à se déculpabiliser.
En résumé : pas de fatalité, pas de tabou, et surtout, pas d’isolement !
Comment reconnaître la fatigue cognitive chez un enfant ou adolescent après un traumatisme crânien ?
La fatigue cognitive se manifeste par une difficulté inhabituelle à se concentrer, à retenir des informations ou à terminer une tâche. Même après un repos suffisant, l’enfant se plaint d’être épuisé mentalement, ce qui correspond rarement à un comportement normal ou à de la « simple flemme ».
Pourquoi la concentration pose-t-elle problème après un accident à la tête chez les jeunes ?
Le cerveau, après un traumatisme crânien, fonctionne au ralenti, comme si ses circuits étaient temporairement saturés ou désynchronisés. Cela complique sérieusement les apprentissages, le suivi des consignes et la gestion des émotions, même si le reste du corps semble en forme.
Quand consulter un psychologue spécialisé pour la fatigue mentale post-traumatique chez l’enfant ?
Dès lors que les symptômes de fatigue ou de troubles de l’attention persistent plus de deux à trois semaines, il est conseillé de consulter. Un psychologue spécialisé en neuropsychologie infantile saura guider et évaluer précisément la situation en Belgique.
Faut-il alerter l’école et demander des adaptations après un traumatisme crânien ?
Oui, il est essentiel d’informer l’école pour mieux organiser la reprise scolaire et mettre en place des aménagements adaptés. La collaboration avec les enseignants et les professionnels de santé maximise les chances de récupération et évite l’isolement de l’enfant.
Références scientifiques :
McAllister TW. “Cognitive Outcome after Mild Traumatic Brain Injury.” Psychiatric Clinics of North America, 2016. Résumé : L’auteur analyse les origines et l’évolution de la fatigue cognitive après TCC léger, soulignant le rôle clé d’une prise en charge précoce.
Mott T, McConnon ML, Rieger BP. “Subacute and chronic symptoms of mild traumatic brain injury.” American Family Physician, 2021. Résumé : L’article détaille les troubles cognitifs et attentionnels persistants chez l’enfant et propose des stratégies de suivi.
Arciniegas DB, et al. “Neurobehavioral Sequelae of Traumatic Brain Injury.” Handb Clin Neurol, 2015. Résumé : L’analyse approfondit l’impact sur la mémoire, l’attention, l’émotion et la récupération après TCC chez les jeunes patients.
Silver JM, McAllister TW, et al. “Management of Persistent Symptoms after Concussion/Mild Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents.” J Child Neurology, 2016. Résumé : Cet article insiste sur l’importance du dépistage précoce et de l’éducation familiale pour mieux gérer les troubles cognitifs post-traumatiques.