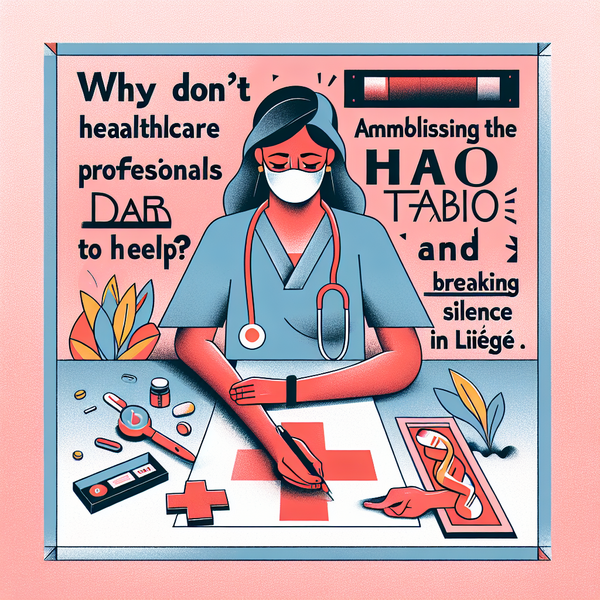 Psy Professionnels de la Santé + Care
Psy Professionnels de la Santé + Care📍 Adresse : Rue Sous les Roches 86, 4130 Esneux
📞 Téléphone RDV : 0494 54 96 32
Vous est-il déjà arrivé de voir un infirmier, un médecin ou une pompière avouer à voix haute : “J’ai besoin d’aide” ? Rares sont ces scènes. Chez les professionnels de la santé et de l’intervention d’urgence (pompiers, policiers, protection civile…), la tendance est généralement à tenir, à encaisser, à repousser toujours plus loin le moment de craquer. Pourquoi ce tabou ? Où s’ancre-t-il ? Derrière la blouse ou l’uniforme se tisse une toile de normes, de mythes et de peurs bien plus solides qu’il n’y paraît.
À Liège, on croise de multiples soignants, du CHU Sart-Tilman aux équipes mobiles. Ce qu’ils vivent, on l’imagine. Ce qu’ils ressentent, beaucoup n’en parlent qu’à voix basse, tard le soir ou jamais. Car demander de l’aide dans ces métiers, c’est parfois comme vouloir boire un verre d’eau dans le désert : c’est vital, mais on ne sait pas où et comment la puiser.
Entrons ensemble dans les coulisses du silence professionnel.
Dès les premiers jours en institut ou à l’école, un message se glisse subtilement dans la tête de chaque futur soignant ou intervenant : il faut “tenir”, être “solide”. L’image du “héros”, indestructible et disponible pour tous sauf pour lui-même, est profondément ancrée dans notre société. Posez la question autour de vous : un secouriste qui faiblit inspire-t-il confiance ? Voilà tout le paradoxe.
Ce cliché a la vie dure. Il se raconte dans les couloirs des hôpitaux et lors des débriefings après une intervention difficile. Il est partout, à la machine à café ou lors des transmissions du soir : “On a signé pour ça”, “il faut s’endurcir”. Mais derrière ce récit glorifiant, le revers de la médaille est dur. Demander de l’aide, ce n’est pas censé être un aveu de faiblesse… Pourtant, tout fait croire que si.
Vous imaginez une chirurgienne épuisée interrompre une opération pour souffler ? Ou un pompier dire devant toute la caserne, “je ne dors plus, ça ne va pas” ? Difficile. Pourtant, humainement, ils en auraient bien besoin…
Le tabou fait des ravages silencieux. Selon une étude de l’INAMI, près d’un soignant sur deux dit ne pas se sentir “légitime” à consulter un psychologue. “Je dois gérer, sinon c’est que je ne fais pas mon travail correctement.” Tirons le rideau : il y a urgence à défaire ce mythe. Car même les plus grands arbres ploient lors des tempêtes.
Mais alors, d’où vient ce sentiment ?
Cela s’enracine souvent dans la culture professionnelle : dans les équipes d’urgences, dans une MRS ou même en cabinet médical, la solidarité se vit fort, mais l’aveu de fragilité reste suspect. “Celui qui craque, c’est celui qu’on ne peut pas mettre en première ligne demain.” Dans certains services, on va jusqu’à surnommer les pauses ou consultations psychologiques “des trucs de fragiles”. Terrible cliché, non ?
Ce phénomène n’a rien de rare aux alentours de Liège, où l’on croise chaque jour de nombreux secouristes, policiers et soignants, presque tous formés à l’abnégation et à la retenue. Alors, chacun tient comme il peut… jusqu’à se fissurer partout, parfois sans bruit.
Devenir professionnel de la santé ou de l’intervention d’urgence, c’est passer par des années d’apprentissage technique... mais surtout, par une formation psychologique implicite. Être témoin de décès, d’accidents, de douleurs, tous les jours, crée un bouclier émotionnel quasi automatique. Ce système d’auto-défense mentale, construit pour durer, devient parfois prison.
On ne vous demande pas “comment ça va vraiment ?”, mais plutôt “tu tiens le coup ?”, “prêt pour une nouvelle garde de nuit ?”. Une nuance, mais pas n’importe laquelle. On apprend ainsi à taire ses émotions. À “faire avec”. Résultat ? Quand le besoin apparaît, il reste coincé en arrière-plan, comme une application qui consomme toute la batterie du téléphone sans qu’on le voie — jusqu’à la coupure inopinée.
Un chiffre ? Plus de 40% des infirmiers en Belgique avouent se sentir “épuisés moralement” au moins une fois par semaine. Pourtant, 80% d’entre eux déclarent n’avoir jamais demandé de soutien psychologique. Scène classique à l’hôpital : lors d’un décès marquant, on en discute cinq minutes et on repart “par respect pour le patient suivant”. Le temps manque, bien sûr. Mais cela n’explique pas tout.
Car la résilience est une arme extraordinaire, mais à double tranchant. Elle permet de continuer quand les autres s’arrêtent. Mais elle pousse aussi à ignorer ses besoins, à “serrer les dents” bien au-delà du raisonnable. À Liège, beaucoup de soignants expliquent que “tenir bon, c’est ce pour quoi je suis payé”. Jusqu’à se demander parfois s’il n’y a pas méprise sur la vraie mission du soignant ou du secouriste. Prendre soin des autres, oui. Mais à quel prix pour soi-même ?
La psychologue Delphine Gilman, qui reçoit régulièrement des professionnels épuisés, confie recevoir ce genre de paroles : “Dès la première minute d’entretien, beaucoup s’excusent d’être là. Comme s’il fallait d’abord justifier la démarche de demander du soutien.” L’empreinte de cette “formation au surhumain” est profonde.
Martine, infirmière en réanimation. 17 ans de métier, jamais un arrêt maladie. Elle raconte ce choc : “Un jour, je me suis mise à pleurer dans les toilettes, sans raison apparente. Je n’étais jamais fatiguée avant. Je n’ai parlé à personne. Je me suis dit que ça passerait.” C’est finalement après plusieurs semaines, voyant sa concentration baisser, qu’elle a accepté de consulter. Tardivement.
Jean, policier à Liège, repense à une intervention difficile : “J’ai refoulé longtemps. J’avais honte de dire que je faisais des cauchemars. Chez nous, la parole c’est pour les blagues, pas pour la peur.” Son entourage l’a incité à franchir la porte d’une psychologue spécialisée. Il ose à peine en parler à ses collègues : “On pense qu’on va être catalogué.”
Des histoires comme celles-ci, il en existe des centaines, que Delphine Gilman recueille dans son cabinet. Elles témoignent toutes d’une même réalité : la formation à la résilience est essentielle, mais elle condamne parfois à l’isolement émotionnel, jusqu’à la rupture.
📍 Adresse : Rue Sous les Roches 86, 4130 Esneux
📞 Téléphone RDV : 0494 54 96 32
La charge de travail ? Le manque de moyens ? Oui, mais pas seulement. Les ambiance de service pèsent aussi lourd dans la balance. Quand les réunions d’équipe ne laissent pas de place à l’expression du mal-être, quand les encadrants ne valorisent que la performance, le message est clair : “Ici, tu tiens, ou tu pars.” En contexte hospitalier, cela se traduit par le manque de dispositifs d’écoute, ou par des “cellules psychologiques” créées en urgence après un drame... mais rarement pérennes. Bref : le soutien existe, mais souvent sous la forme d’un pansement sur une jambe de bois.
D’après un rapport du CHU de Liège, seuls 22% de soignants disent connaître l’existence d’une aide psychologique institutionnelle. Pire : la moitié ne sait même pas à qui s’adresser pour y accéder. Un comble dans des établissements qui se veulent “prêts à tout”.
Autre frein : la crainte de la stigmatisation. Beaucoup appréhendent que la consultation soit notée dans le dossier, ou même évoquée lors des évaluations annuelles. Comme si un moment de vulnérabilité devenait une tache sur un parcours irréprochable. Cette peur est largement partagée, même aux urgences où la saturation émotionnelle est monnaie courante.
La surcharge administrative joue un rôle aussi : à force de courir d’un patient à un autre, comment trouver ne serait-ce qu’un quart d’heure pour prendre soin de sa santé mentale ? Dans certaines équipes, l’absence à une séance de groupe (psy ou autre) doit être justifiée comme un acte presque suspect. Résultat : beaucoup renoncent avant même d’avoir essayé. Plus simple de fermer la porte, de continuer “comme si de rien n’était”, en priant que ça tienne jusqu’aux prochaines vacances. Si elles arrivent un jour…
Une étude parue en 2021 sur sciencedirect.com conforte ce constat : la simple existence d’un espace sécurisant et confidentiel ferait chuter de plus de 30% les symptômes anxieux chez les soignants interrogés. Mais en pratique, ces espaces manquent, et le temps aussi.
Du côté des services d'urgence, même constat : le fameux “débriefing à chaud” après une catastrophe est rarement suivi d’un vrai accompagnement dans la durée. “On fait le point, puis c’est retour à la norme. Comme si on devait tout digérer d’un coup, puis oublier”, confie une ambulancière aux alentours de Liège.
On parle beaucoup du burnout des soignants ces dernières années. Mais le vrai tabou qui persiste ? Le manque de dispositifs concrets pour demander de l’aide sans risque. Parfois, ce n’est même pas la peur de parler. C’est juste le constat froid : il n’y a pas de porte à laquelle frapper.
Face à ce mur du silence, quelles solutions ? La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des chemins pour sortir de l’ombre. Parfois sinueux, ils commencent souvent par un tout petit déclic. Oui, il faut du courage. Mais pas celui dont on parle dans les séries télé… Non, le vrai courage : celui de s’écouter, de poser des mots, et d’oser frapper à la bonne porte.
Première étape : reconnaître le besoin. Plus facile à dire qu’à faire ? Certainement. Pourtant, il s’agit juste d’un premier signal, comme une alarme douce qui clignote dans un coin de la conscience. Fatigue excessive, troubles du sommeil, irritabilité, perte de l’enthousiasme… Ce sont des signaux, pas des défauts ! Vous vous levez fatigué, même après huit heures de sommeil ? C’est peut-être un signe que le corps n’arrive plus à suivre. “Il faut apprendre à ne pas attendre d’être au bout du rouleau”, souffle Madame Gilman, qui observe la même chose lors des suivis individuels ou en groupe.
Et ensuite ?
La solution passe souvent par la rencontre. Prendre contact avec un(e) psychologue spécialisé(e) dans l’accompagnement des professionnels du soin ou de l’intervention est aujourd’hui plus simple qu’il n’y paraît. Il existe des spécialistes de confiance, parfaitement formés à comprendre les spécificités de ces métiers. Parmi eux, Delphine Gilman, à Esneux, accueille chaque semaine des soignants, médecins, policiers, pompiers, pour leur permettre de déposer enfin leur vécu hors du cadre du service.
La première consultation peut déjà débloquer beaucoup. Pas besoin d’attendre l’effondrement pour agir. Pensez à une révision de voiture : mieux vaut anticiper les pannes que les subir sur l’autoroute. En bénéficiant d’un soutien psychologique précoce, nombre de professionnels ont évité la spirale du burnout ou le fameux “bout du rouleau” si difficile à remonter.
Autre clé : le collectif. Dans certains hôpitaux, la mise en place de groupes de parole “anonymes” a permis à plus de 60% des soignants participants de renouer avec le plaisir du métier, en se sentant compris, reconnu (étude “Soins & Soutien”, 2022).
En Belgique, plusieurs initiatives voient le jour pour renforcer ce maillage précieux autour des professionnels. Certaines plateformes facilitent la prise de rendez-vous, d’autres proposent un accompagnement sur mesure, discret et adapté au rythme de chacun. Le principal reste de convaincre les équipes — et les directions — que prendre soin de la santé mentale, ce n’est pas un luxe ni un signe de faiblesse, c’est juste la base pour durer et s’épanouir.
“Le courage, c’est parfois d’avouer que ça ne va pas”, confie une cheffe de service à Esneux. Ses mots résonnent. Demander de l’aide, c’est justement une preuve de force, car cela signifie avoir compris que personne n’est infaillible. L’humain, ce n’est pas Superman. C’est fragile. Et c’est cette vulnérabilité qui nourrit une résilience authentique, partagée, durable.
Un dernier mot ? Aux soignants, aux policiers, aux pompiers : s’accorder du soutien, c’est préserver son étincelle de vie. C’est poser une pierre solide pour le futur.
Comment reconnaître les premiers signes qu’un professionnel du soin a besoin d’aide ?
Les symptômes sont souvent subtils : fatigue persistante, perte d’énergie, troubles du sommeil, irritabilité et tendance à l’isolement. Chez certains, c’est une perte de plaisir au travail ou le sentiment de ne plus arriver à “récupérer” entre les périodes de stress. Mieux vaut rester attentif à ces signaux et ne pas attendre l’épuisement complet pour réagir.
Pourquoi la culture du “sacrifice” est-elle si forte dans le milieu du soin et de l’intervention ?
Cette culture s’est développée au fil des générations, valorisant ceux qui tiennent bon quoiqu’il arrive, parfois au détriment de leur propre bien-être. Elle repose sur l’image du professionnel “indestructible”, censé incarner la force pour rassurer les patients ou victimes. Cependant, cette attitude empêche souvent de demander de l’aide quand le besoin se fait sentir.
Quand faut-il consulter un psychologue spécialisé dans le soutien aux professionnels de la santé ?
Dès les premiers signes de mal-être ou de surcharge, il est recommandé de prendre rendez-vous, même à titre préventif. Un accompagnement précoce permet de trouver des solutions adaptées avant que la situation ne s’aggrave et d’éviter le risque de burn-out, très fréquent chez les professionnels du soin.
Faut-il s’inquiéter de la confidentialité lorsqu’on consulte pour un accompagnement psychologique en institution ?
Dans la plupart des établissements, la confidentialité est strictement respectée et rien n’est communiqué sans l’accord du patient. Si des doutes subsistent, il est préférable d’en parler avant la première séance avec le psychologue pour clarifier ces points et se sentir serein dans la démarche.
Mots-clés : psychologue, professionnels de la santé, burnout, demander de l’aide, tabou, soignants, culture du sacrifice, résilience, soutien psychologique, confidentialité
Bruffaerts R. et al., “Mental Health Problems in Healthcare Workers during the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Study”, Journal of Psychiatric Research, 2021. Cette étude analyse l’évolution du bien-être psychique chez les soignants en situation de crise.
Poghosyan L. et al., “Nursing Work Environment and Burnout”, Research in Nursing & Health, 2020. L’impact des conditions de travail sur l’épuisement professionnel est détaillé, avec un focus sur la prévention.
García-Campayo J. et al., “Burnout Syndrome and Demands in Healthcare Professionals: A Systematic Review and Meta-analysis”, Medicina Clinica, 2018. Cette revue met en évidence la prévalence du burnout et l’importance du soutien psychologique.
Santomauro, D. et al., “Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic”, The Lancet, 2021. L’article met en exergue l’augmentation mondiale des troubles anxieux, avec un zoom sur les professionnels du soin.