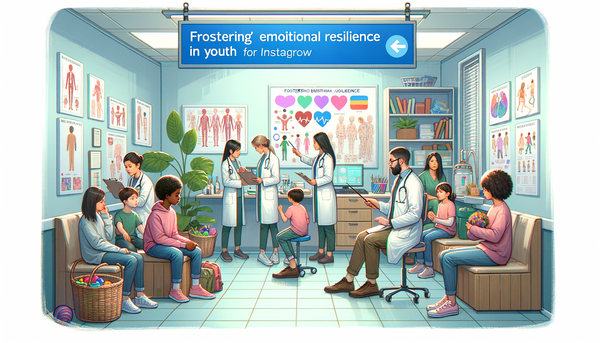 Psy Enfant - Ado
Psy Enfant - AdoPsychologue – Mme Ariane Humblet
📍 Adresse : Rue Sous les Roches 86, 4130 Esneux
📞 Téléphone RDV : 0495 66 00 61
Vous avez peut-être déjà entendu “Il lui en faut peu pour pleurer !”, ou “À son âge, on ne se posait pas autant de questions”. Aujourd’hui, l’enfance et l’adolescence semblent traversées de plus en plus tôt par des tempêtes émotionnelles : angoisses, stress à l’école, séparations parentales compliquées, harcèlement… Les jeunes sont secoués dans tous les sens. On ne peut pas leur épargner toutes les difficultés, on le sait – mais on peut leur apprendre à ne pas sombrer à chaque vague. Ce “quelque chose” qui leur évite de s’écrouler quand tout s’effondre, c’est ce que l’on appelle la résilience émotionnelle.
Alors, comment aider son enfant à bâtir cette force tranquille ? Par quels outils développer, petit à petit, ce matelas invisible qui leur permettra de rebondir ? Ici, vous découvrirez pourquoi cette capacité doit s’apprendre dès l’enfance, comment l’encourager au quotidien, et quels signes guetter pour intervenir à temps. Prêts à planter de jolies racines chez votre ado, ou chez un bout de chou fragile ? Suivez le guide.
La résilience émotionnelle, c’est la capacité à faire face aux chocs de la vie sans s’effondrer. C’est la faculté d’encaisser un coup dur ou une déception, pour ensuite redresser la tête, tirer des leçons, et grandir de l’expérience. Vous voyez un roseau qui ploie au vent, puis se relève ? C’est ça, la résilience. Mais chez l’enfant et l’adolescent, cette force n’est pas innée. Elle se construit à force d’expériences et de rencontres.
On confond parfois la résilience avec de l’indifférence, du fait d’ignorer ses émotions ou de “prendre sur soi”. Or, être résilient n’a rien à voir avec le fait de ne jamais être triste ou touché ! Un jeune résilient va ressentir, parfois intensément, la tristesse, la colère ou la frustration. Mais il va aussi être capable de retrouver confiance, de demander de l’aide, ou de repenser sa manière de voir les choses.
Les études menées en Belgique et dans d'autres pays montrent que la résilience émotionnelle influence énormément le bien-être des enfants et adolescents. Ceux qui s’y retrouvent le mieux traversent plus facilement :
Elle agit un peu comme une boîte à outils d’urgence. Imaginez un ado qui doit soudain déménager après un divorce : s’il a développé une bonne sécurité intérieure, il éprouvera des coups de mou, peut-être des peurs, mais parviendra à reprendre pied, à demander du soutien, à retrouver des repères dans un nouvel environnement.
À l’inverse, un jeune manquant de résilience risque de s’effondrer ou de figer ses émotions : anxiété, isolement, troubles du sommeil, voire fuite scolaire. Selon un rapport de l'OCDE datant de 2022, un élève belge sur cinq présente des signes d'anxiété forte ou de difficultés d’adaptation lors d’évènements de vie difficiles.
Bonne nouvelle : ce matelas de sécurité n’est pas réservé aux “naturellement forts”. Quelle que soit sa sensibilité, chaque jeune peut apprendre à mieux rebondir. Mais comment repérer ceux qui en ont besoin ?
Les signes d’une faible résilience chez les jeunes :
Heureusement, des leviers concrets existent. Avant d’y plonger, petit rappel important :
Psychologue – Mme Ariane Humblet
📍 Adresse : Rue Sous les Roches 86, 4130 Esneux
📞 Téléphone RDV : 0495 66 00 61
Il n’existe pas de recette miracle (dommage, non ?), mais plusieurs facteurs-clés jouent un rôle crucial. La famille, le cercle social, l’image de soi, la gestion des émotions… Chacun apporte une brique à la maison “résilience”. Passons-les au peigne fin, avec des exemples vécus à Liège ou ailleurs.
Tout commence (forcément) par la petite enfance. Les tout-petits qui reçoivent des réponses constantes à leurs besoins émotionnels développent une sorte de socle invisible : l’attachement. Ils apprennent, sans le conscientiser, qu’une personne fiable viendra les apaiser quand le monde leur fait peur. Cette “bulle de sécurité” personnelle, c’est la base d’une résilience future.
De nombreux travaux l’ont montré : ce n’est pas la quantité de temps passée avec l’enfant qui compte, mais la façon dont il se sent compris (même quand il ne parle pas encore). Un parent qui accueille les larmes, qui apprend à nommer les sentiments, envoie ce message : “tes émotions sont valides, je suis là, tu peux aussi trouver des solutions”. On installe la première pierre d’une solide construction intérieure.
Chez les adolescents, l’attachement se transpose. Ils cherchent des zones “sûres”, des adultes référents – parents, enseignants, tuteurs, parfois professionnels comme un psychologue pour adolescents. Même lorsqu’ils semblent rejeter l’autorité parentale, ils ont besoin d’un socle ferme sur lequel s’appuyer pour se lancer dans l’inconnu.
C’est là que l’éducation émotionnelle intervient : oser dire “je” au lieu de “tu”, enseigner la frustration, reconnaître l’injustice, mais aussi exprimer sa fierté. Le tout, petit à petit. L’image idéale ? La famille fonctionne comme un trampoline : elle amortit les chocs, mais relance l’enfant vers l’autonomie.
Des études menées dans les écoles à Liège montrent que les jeunes bénéficiant d’un dialogue émotionnel ouvert dans la famille affichent moins de symptômes anxieux face aux examens ou aux changements scolaires.
Vous ne savez pas par où commencer ? Il existe plusieurs ressources pour renforcer ces compétences, notamment auprès de professionnels formés à la psychologie enfantine. Vous pouvez aussi consulter des articles approfondis comme gestion de la pression parentale, ou demander un test de QI chez l’enfant afin de mieux cerner les forces et faiblesses de votre jeune.
La confiance en soi et l’autonomie : deux piliers complémentaires
Un jeune résilient, c’est un jeune qui a appris à se faire confiance, même lorsqu’il ne réussit pas tout du premier coup. C’est la fameuse “mentalité de croissance” : au lieu de penser “je suis nul”, il apprend à se dire “j’ai le droit d’apprendre et de progresser”. Cette compétence s’enseigne, elle n’est pas magique.
Donner des petites responsabilités, valoriser les progrès (pas seulement les réussites !), laisser essayer, se tromper, et recommencer : toutes ces micro-expériences d’autonomie pavent la route. Un ado qui a le droit de choisir (ses vêtements, ses activités, son organisation) se sent acteur de sa vie – même dans l’adversité.
Attention cependant : autonomie ne signifie pas tout autoriser. Les limites bienveillantes restent essentielles. “Tu peux essayer, mais voilà le cadre”. Cela rassure plus qu’on ne l’imagine.
La gestion émotionnelle : apprendre à apprivoiser la tempête
Personne n’a la notice pour vivre sans peur, ni tristesse. Mais apprendre à reconnaître, nommer et exprimer ses émotions, c’est déjà une grande victoire. Cela évite d’accumuler, de se bloquer ou de “sortir” tout d’un coup (cris, claquements de porte, silences dévastateurs).
Des exercices simples, comme le journal des émotions (“quelle couleur as-tu aujourd’hui ?”, “qu’est-ce qui t’a fait sourire ou pleurer cette semaine ?”) aident les enfants comme les ados à faire le tri. On peut aussi utiliser des jeux de rôle, des histoires, ou simplement une discussion autour d’un film. L’idée ? Évacuer la pression, mettre des (bons) mots sur ce qui fait mal.
Si vous sentez qu’un jeune s’enferme complètement, ou adopte des comportements à risque, n’attendez pas que la crise passe. Consultez un professionnel, tel que Psychologue – Mme Ariane Humblet.
Vous vous demandez peut-être : concrètement, comment cultiver cette “peau épaisse” chez un enfant sensible ? Comment aider son ado à surmonter déceptions et échecs à répétition ? Il ne s’agit pas de surprotéger, ni de faire semblant que tout va bien. Mais d’accompagner, de réconforter, et d’outiller. Voici quelques stratégies validées “sur le terrain”, à appliquer aux alentours de Liège comme partout ailleurs.
1. Développer l’empathie et la communication
Vous voulez une image ? L’empathie, c’est la boussole qui empêche de se perdre dans la tempête. Apprendre à écouter, à comprendre le point de vue des autres, mais aussi à se sentir entendu, c’est la base de la résilience. Pourquoi ? Parce que cela permet à l’enfant ou à l’ado de se sentir “relié”, jamais seul face aux coups du sort.
Mettez en place des rituels, par exemple le fameux “qu’est-ce qui t’a fait plaisir ou dérangé aujourd’hui ?”. Invitez aussi à parler des soucis (petits ou grands). Au fil du temps, l’enfant comprend qu’il n’est pas “faible” parce qu’il a mal, qu’il peut demander du soutien.
2. Mettre en valeur les réussites et efforts
On a tendance à pointer le négatif (“tu as oublié de ranger !”, “encore une mauvaise note…”). Or, valoriser les mini-avancées est bien plus constructif. Un enfant qui entend : “tu as super bien persévéré, même quand c’était compliqué”, intègre qu’il a les ressources pour surmonter des difficultés. Cela augmente sa confiance et, par ricochet, sa résilience.
3. Encourager la prise de distance face aux problèmes
Quand tout va mal, on a le nez collé aux soucis. Aider un jeune à prendre du recul, à “regarder le tableau dans son ensemble”, c’est lui offrir une échelle pour sortir du puits. Utilisez des métaphores : “Si ta vie est une feuille, ce n’est pas parce que tu as une tache qu’elle est fichue. On peut dessiner autour, ou recommencer”.
Pour les plus grands, discutez des expériences passées où ils se pensaient incapables, mais ont finalement surmonté l’obstacle. Valorisez la progression, pas l’idéal de perfection (qui blesse plus souvent qu’il ne rassure).
4. Créer un climat où l’erreur est permise
Cela paraît simple, mais combien de jeunes n’osent plus essayer par peur de l’échec, de la punition, ou du jugement ? Faites de la maison un laboratoire d’expériences. On peut se tromper, c’est autorisé – voire nécessaire pour apprendre.
Montrez l’exemple : racontez vos propres erreurs, vos difficultés, avec un peu d’humour ou de recul. Cela humanise l’adulte, dédramatise l’erreur et encourage à recommencer malgré les échecs.
5. Soutenir les réseaux sociaux positifs
Les amis, les activités collectives, les clubs sportifs… Tout ce qui nourrit l’appartenance aide à encaisser les coups durs. Encouragez les jeunes à ne pas s’isoler, à chercher des groupes dans lesquels ils se sentent compris, même si ce n’est pas toujours à l’école. Parfois, un club de dessin fait plus pour l’estime de soi qu’un bulletin scolaire.
6. Proposer des repères stables et rassurants
Les routines (même imparfaites !), les horaires, les traditions familiales : tout ce qui crée un espace “prévisible” apaise le cerveau des jeunes en construction. Quand le monde extérieur paraît chaotique, savoir qu’il y aura toujours un repas, une histoire, ou simplement une présence, c’est précieux.
7. Observer et intervenir si besoin
Vous sentez que certains signaux d’alerte persistent ? Un jeune s’isole, déclenche des crises de larmes sans raison, peine à retrouver de l’insouciance ? Le repérage précoce est essentiel. Ne restez pas seuls. Des professionnels formés interviennent spécifiquement pour les jeunes en souffrance émotionnelle et peuvent aider à comprendre ce qui bloque la progression.
N’ayez pas peur de consulter. Parfois, un accompagnement court suffit pour donner un nouvel élan.
Malgré l’amour, la bienveillance, et vos efforts du quotidien, certains jeunes n’arrivent pas à franchir seuls le cap de la résilience. Pourquoi ? La psychologie de l’enfant et de l’adolescent reconnaît que, parfois, des blessures anciennes, des traumas non-élucidés, ou des vulnérabilités neurodéveloppementales freinent le processus. D’où l’importance de savoir “lâcher la main, mais trouver une autre main, experte, qui guide”.
Voici des signaux d’alerte qui indiquent qu’il est peut-être temps de consulter pour renforcer la résilience de votre enfant ou ado :
Dans tous ces cas, le professionnel de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent propose une écoute neutre et soutenante. À travers l’entretien, le jeu, ou des outils émotionnels (jeux de rôles, relaxation, exercices d’affirmation de soi…), il aide le jeune à :
La prise en charge de la résilience n’est donc jamais “culpabilisante” pour la famille. Au contraire, elle s’inscrit dans un partenariat, où chacun retrouve sa juste place. On entend souvent certains parents dire : “Je devrais y arriver tout seul, c’est ma mission.” Mais n’oubliez pas : accepter de l’aide, c’est aussi montrer à son enfant qu’il n’est pas obligé d’être toujours fort, qu’il peut déléguer quand il n’a plus de solution.
Enfin, il n’y a pas “d’âge idéal” pour commencer ce travail. Même un adolescent en rébellion peut (souvent après un temps de réticence) découvrir l’intérêt d’avoir un espace à lui, pour mettre de l’ordre dans sa météo intérieure.
À titre d’exemple, de nombreux parents suivent un accompagnement ponctuel, même pour un seul entretien. Cela permet de mieux comprendre le vécu de leur jeune, d’anticiper d’éventuels blocages, ou simplement de réajuster leur propre posture parentale. C’est ce que propose, entre autres, la psychologue spécialisée à Esneux, près de Liège.
Comment savoir si mon enfant manque de résilience émotionnelle ?
Les signes sont souvent une difficulté à surmonter les échecs, une tendance à s’isoler face aux problèmes, ou une réaction émotionnelle très forte et persistante lors d’imprévus. Il peut aussi montrer du découragement ou de la colère face à la moindre difficulté. Si ces comportements se répètent, il est utile de consulter un professionnel.
Pourquoi est-il important de renforcer la résilience émotionnelle chez les jeunes ?
La résilience aide les enfants et adolescents à affronter les épreuves de la vie sans se laisser submerger par l’anxiété ou la tristesse. Elle favorise une meilleure santé mentale sur le long terme et facilite l’adaptation aux changements, comme le passage au collège ou de nouvelles situations familiales. C’est un atout clé pour l’équilibre et le bien-être, à chaque étape de leur développement.
Quand consulter un psychologue pour un problème de résilience émotionnelle chez l’enfant ou l’ado ?
Il faut consulter lorsque vous remarquez un mal-être qui dure (plusieurs semaines), des troubles du sommeil ou de l’alimentation, un isolement inhabituel, des réactions émotionnelles incontrôlées ou un décrochage scolaire. Un entretien préventif peut aussi être bénéfique pour outiller l’enfant avant des étapes difficiles (déménagement, séparation, entrée en secondaire…).
Faut-il agir différemment selon l’âge de l’enfant pour renforcer sa résilience émotionnelle ?
Oui, les outils et le langage varient avec l’âge. Chez les plus petits, cela passe par le jeu et la verbalisation des émotions. Chez les adolescents, on privilégiera le dialogue, l’autonomie et la valorisation des compétences sociales. Dans tous les cas, la disponibilité émotionnelle de l’adulte reste fondamentale.
- Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. Child Development, 85(1). L'auteur souligne l'importance de la résilience développée dès l'enfance face aux adversités de différents contextes culturels.
- Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3). Cet article propose une synthèse sur la notion de résilience et ses implications cliniques.
- Dumont, M., & Provost, M. A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28(3). La recherche montre que le soutien social et la valorisation de soi renforcent la résilience face au stress.
- Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to Adulthood. Ithaca, NY: Cornell University Press. Cette étude longitudinale démontre que certains facteurs familiaux protègent contre la vulnérabilité psychosociale à long terme.